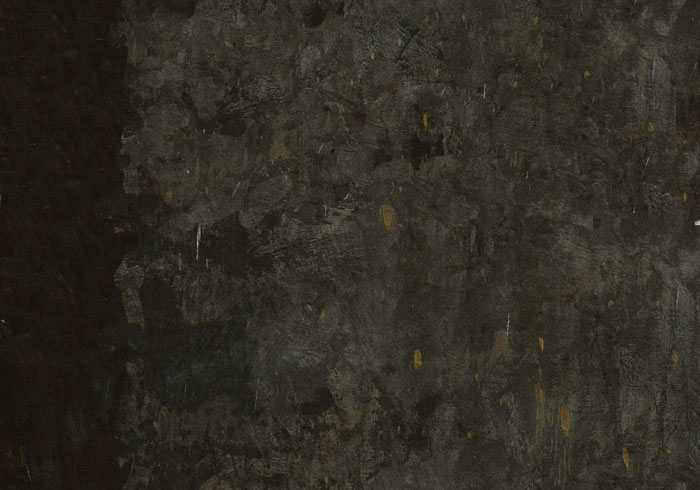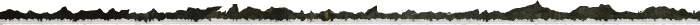


«Sale petit monstre, tu n'as pas pu résister, hein ? Il a fallu que tu recommences !... »
Elle vient de m'allonger une gifle magistrale. Sous le choc, les murs se mettent à danser, puis la pièce tout entière glisse brusquement sur le côté. Je termine mon vol plané dans un coin. Maman peut ainsi parfois faire preuve d'une force colossale.
Les mains ramenées sur le visage, je me roule en boule pour offrir moins de prise à sa colère. À travers l'interstice que font deux de mes doigts, j'aperçois, au-dessus de moi, très haut, le visage cramoisi de ma mère. Un masque convulsé, crachant et écumant. Les lunettes, de travers, tiennent encore par miracle au bout du nez minuscule, tandis que de longues mèches s'échappent du chignon en bataille pour venir, à chaque mouvement, se rabattre sur les yeux... Plus bas, les mains, les poings, puis les talons ou encore les genoux distribuent leurs coups au hasard, et me labourent le ventre, les joues, les fesses...
C'est toujours ainsi, lorsque j'avale la queue du chat.
Maman ne peut supporter de voir l'animal tendrement chéri amputé par mes soins d'une partie qu'elle estime sans doute essentielle à son anatomie. Elle devrait pourtant comprendre à quel point il m'est difficile de ne pas céder à l'appel de cette chose tendre, longue et velue, qui, par lentes reptations, vous descend dans l'œsophage, avant de se rouler en une grosse pelote soyeuse au fond de l'estomac... Non ! au lieu d'admettre les faits une bonne fois pour toutes, au lieu de conserver l'animal infirme de façon à ce que je n'aie plus de queue à me mettre sous la dent, chaque semaine, elle abandonne le blessé à quelque vieille du voisinage, et revient à la maison avec un chat tout neuf, intact, délicieusement muni. De sorte que, chaque semaine, je succombe à la tentation et que, chaque semaine, c'est la guerre.
Quant à tolérer ce qui n'est somme toute qu'une innocente lubie, voilà qui dépasserait ses forces. Je fais pourtant les choses proprement. Je m'allonge près de la bête, en la caressant. Je saisis délicatement l'extrémité de son panache entre deux doigts et, la tête à demi renversée en arrière, j'ingurgite le long appendice velu. L'animal généralement n'oppose pas la moindre résistance. Puis, lorsque le bout de mon nez atteint le bas de son dos, je coupe la queue. Net. D'un coup d'incisives. Le chat ne souffre guère et saigne finalement assez peu. Pas une seule fois je n'ai taché la moquette.
Maman s'est souvent demandé d'où pouvait me venir ce goût contre nature, cette perversion qu'elle appelle par jeu, lorsqu'elle est dans ses bons jours, mon channibalisme... Persuadée que la disparition tragique de mon père, voici sept ans, y était pour beaucoup, elle s'est montrée, dès le début de la maladie, extrêmement attentive aux moindres de mes gestes, aux plus innocents de mes regards.
C'est ainsi qu'elle a tout tenté, du moins dans les premiers temps, pour venir à bout de mon vice. Je n'avais pas encore avalé ma cinquième queue, qu'elle me traînait déjà chez un psychiatre...
Je n'ai qu'un souvenir extrêmement vague de cette période-là. Je conserve seulement quelque part au fond de ma mémoire l'image d'une petite pièce où régnait une demi-pénombre. L'odeur curieuse qui flottait dans l'air constituait la seule prise qui s'offrît à mon esprit en matière de distraction. Car pour le reste, les meubles rares, les murs entièrement nus et les rayonnages sévères d'une petite bibliothèque paraissaient conçus pour éviter d'accrocher le regard. Non, il n'y avait décidément que cette odeur, comme venue de très loin. Mais où donc avais-je pu sentir quelque chose qui ressemblât à un aussi curieux mélange de musc et de suint ?
On me désignait une sorte de sofa perdu dans l'obscurité, et l'on m'aidait à m'y étendre. Le médecin était une petite femme, un peu boulotte, au timbre de voix rassurant et agréable. Elle me caressait les cheveux tout en m'interrogeant. Je me sentais en confiance. Porté par l'odeur entêtante, je répondais de mon mieux. Je me souviens essentiellement de la description que je lui faisais alors de l'étrange douceur pénétrant ma gorge à l'instant exact où je décrochais la queue. Ce mol abandon, dans un frisson soyeux, d'autant plus doux qu'il suivait un brusque raidissement des poils. Puis la descente, de sphincter en sphincter, lente et souple, idéalement sinueuse.
Ceci mis à part, j'ai presque tout oublié de nos entretiens, ses questions comme mes réponses. Je me rappelle seulement qu'elle revenait régulièrement sur le problème de mon aversion pour les chats. J'ignore ce que je m'efforçais de lui expliquer alors. Mais je conserve le sentiment d'une terrible frustration, car il me semblait impossible de la convaincre sur ce point précis : je ne nourrissais aucune haine, aucun dégoût pour l'espèce féline ; je ne souhaitais pas le moindre mal aux compagnons de ma mère et éprouvais plutôt à leur égard une sorte d'indicible tendresse...
Qui renonça, de ma mère ou de ma douce inquisitrice ? toujours est-il qu'au bout de deux ou trois mois, un terme fut mis à ces séances, et cette décision, je l'avoue, me laissa le plus vif regret.
Ma mère me traîna chez d'autres spécialistes. Sans plus de résultats. Tous conclurent, après mille examens dans lesquels maman dut engloutir une petite fortune, qu'on ne connaissait pas de remède à mon mal. Je revois parfois en rêve leurs faces sérieuses, réunies au même tribunal, m'observant derrière d'épaisses lunettes, leurs gestes de Grand Inquisiteur, me condamnant à demeurer jusqu'à la tombe – et peut-être au-delà – un affreux avaleur de queues de chats...
Ce fut alors qu'abandonnée par la science et la raison, poussée aux dernières extrémités, ma mère n'entrevit plus d'autre planche de salut que le surnaturel et la magie.
Ici, mes souvenirs ressemblent réellement à un cauchemar. Je ne puis certifier que tout me soit arrivé ainsi que je vais m'efforcer de le décrire. Je sais seulement que, derrière ce que mon imagination d'enfant a pu amplifier ou déformer, demeure, mais dans une mesure que je suis incapable de préciser, une large part de vérité.
Des kilomètres de routes poussiéreuses nous avaient conduits, maman et moi, jusqu'à une cabane sordide, perdue au fond des marais. Tout autour de nous montaient des fumées épaisses et nauséabondes, comme les exhalaisons malsaines d'un sol qu'on aurait pu croire en complète putréfaction. Sitôt que ma mère eut frappé, un être inquiétant tendit son cou décharné à travers l'entrebâillement de la porte. J'eus un mouvement de recul devant l'apparition de cet affreux visage ridé et parcheminé, dont on ne pouvait jurer qu'il fût mâle ou femelle. Mais maman, tout en donnant du « chère madame » à notre hôte, me poussa à l'intérieur.
L'antre était enfumé et puant. Un désordre indescriptible y régnait. La chose en noir – je n'ose dire la sorcière – nous entraîna dans un véritable dédale – une procession rituelle ? Nous naviguions entre les carcasses d'objets aux formes invraisemblables et les dépouilles de tout ce qui peut se concevoir en matière d'espèces animales. L'usage d'un tel bric-à-brac demeurait fort mystérieux à mes yeux. Mais son utilité ne devait pas faire l'ombre d'un doute dans l'esprit de la maîtresse de maison, puisqu'il s'entassait jusque dans les moindres recoins, dût-il en faire craquer les murs. C'est en tout cas en raison de ce capharnaüm, et bien que l'unique pièce composant la bicoque pût paraître minuscule, qu'il nous fallut décrire un chemin interminable et effroyablement compliqué avant d'atteindre la cheminée, seule source de lumière qui s'offrît à nos yeux...
La vieille se campa devant le feu et déclama d'abracadabrantes formules accompagnées de gesticulations saugrenues. Puis elle effectua une série de passes magnétiques, dont l'une revenait à intervalles réguliers et consistait à faire courir son index long et crasseux sur mes lèvres. Elle fit ensuite bouillir, dans un gros chaudron de cuivre pendu à la crémaillère, un petit animal dont je ne sus jamais s'il avait été souris, grenouille ou lézard. Après quoi, elle me banda les yeux et me fit ingurgiter son infecte cuisine. Je dus, selon toute vraisemblance, avaler la bestiole entière, peau et os compris, car je me souviens assez bien que cela craquait sous la dent. Un goût amer me resta sur la langue.
La sueur me monta soudain au front, et une douleur aiguë au bas-ventre me plaqua contre le sol. Écumant, criant, hoquetant, je me roulai par terre pendant un temps qui me parut interminable. Puis tout se calma subitement, et j'entendis la vieille confier à ma mère :
– Ça y est, l' diab' a sorti !
Le retour à la maison fut, du moins pour ce qui me concerne, particulièrement lugubre. Nous n'échangeâmes pas un mot de tout le trajet. Le malaise que semblait traduire pareil silence ne parut pas cependant affecter maman outre mesure car elle chanta du début jusqu'à la fin.
Il reste que cette pénible expérience n'aboutit à aucune amélioration sensible. Deux jours ne s'étaient pas écoulés que je sombrai à nouveau dans le mal, la luxure et les orgies caudales.
Sans que rien, ni personne n'en pût venir à bout.
Voilà où nous en sommes à présent. Bien des années se sont écoulées, mais rien n'a fondamentalement changé. Tant que je laisse au chat toute sa dignité, nous menons une existence normale. Je pars pour le collège le matin de bonne heure et ne rentre qu'assez tard le soir. Le couvert est déjà mis. Trois assiettes : une pour le chat, une pour maman et une pour moi. Car il dîne avec nous. Je devrais dire plutôt que nous dînons avec lui. Comme lui. À quatre pattes, sur le carrelage, de quelques bouchées de pain dans une assiette de lait, et de croquettes Chacâlin, bœuf et légumes tendres. Ma mère lance de temps en temps un regard langoureux à droite. Sa prunelle verte s'illumine à mesure qu'elle s'attarde sur la forme souple et racée de son compagnon, sur le poil lustré et impeccable. Mouvement caressant d'une amande de feu qui éveille chez son vis-à-vis un ronronnement de plaisir. Puis, maman tourne la tête, ses yeux se posent sur moi et leur couleur vire aussitôt. Je devine combien lui pèse la vue de ce fils qui ne sait pas manger proprement, qui renverse son lait un peu partout et semble si gauche ainsi, à croupetons devant son écuelle.
Le dîner pris, nous faisons une rapide toilette et montons nous coucher...
Les jours se succèdent, tous aussi tranquilles et identiques, jusqu'à ce que la maladie reprenne le dessus, jusqu'à ce que j'abuse de la confiance de la brave bête. Alors commencent les cris, les gifles, les larmes, le pugilat. Maman, armée d'un manche à balai me poursuit de la cave au grenier. Dans ma fuite, je renverse les fauteuils, brise les lampes. La maison se retrouve bientôt sens dessus dessous.
Je me rue vers un dernier retranchement, un coin obscur, sans issue. Alors les coups pleuvent. Le chat assiste au spectacle, et bien qu'il miaule à fendre l'âme en se léchant le postérieur, je parviens à discerner, entre deux bourrades, l'inquiétante satisfaction que trahissent ses yeux mi-clos.
Une fois la colère passée, la maison tranquille et rangée, ma mère partie faire des courses avec l'invalide, je m'enfuis par le jardin, et franchis d'un saut le muret de pierre pour me retrouver chez le voisin. La petite fille vient à ma rencontre. Comme toujours, les après-midi où gronde ainsi l'orage familial, elle a mis sa jolie robe blanche.
Elle me sourit, me cajole, et, entre deux baisers, murmure, compatissante :
– Elle t'a encore battu !
Le mouchoir de batiste vient sécher mes larmes. J'éclate bientôt de rire, et, main dans la main, nous nous dirigeons vers la cabane, au fond du grand parc. Elle pousse, avec d'infinies précautions, la petite porte vermoulue, pénètre la première dans ce qu'elle appelle « notre maison », puis me toise d'un air résolu pendant que, la tête dans les épaules, je me glisse avec difficulté sous le linteau. Lorsqu'enfin j'ai réussi à franchi le seuil, elle referme soigneusement le vantail branlant.
Nous jouons alors des heures durant, à l'abri entre les murs de planches. À des choses extrêmement complexes dont elle invente au fur et à mesure le nom et les règles : la marelle écossaise, le soleil de jade, etc.
Puis, quand elle est à court d'idées, elle fait courir ses lèvres sur ma joue, remonte jusqu'à l'oreille, et dans un murmure propose le dernier jeu. Il lui faut insister longtemps avant que je rende les armes. Mais je finis toujours par me laisser convaincre. Je soulève alors les pans de ma chemise, tandis qu'elle, frémissante, se prépare à caresser une fois encore la longue chose velue et serpentine qui m'orne le bas du dos...
Récit publié à l'origine
sous la forme d'un livre-objet,
aux Éditions du Fragment (Paris, 1994).

dimanche 21 février 2010

Pierre Auguste Renoir, Le Garçon au chat (détail), 1868, huile sur toile, 123 x 66 cm, Paris; Musée d'Orsay.