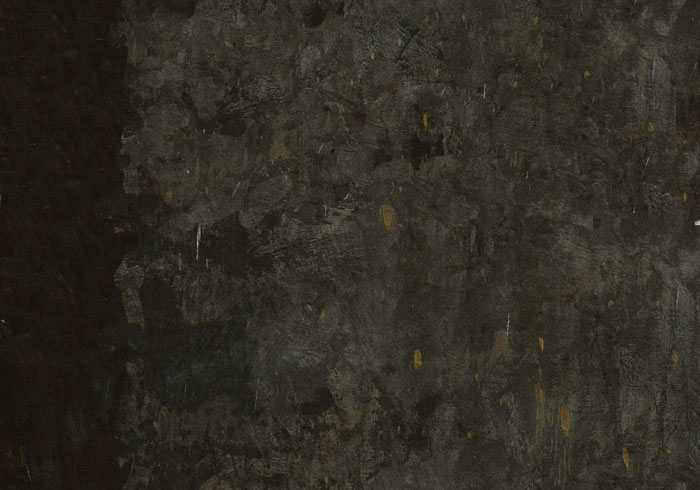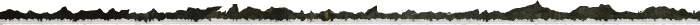


Nous l'avons vu déboucher à l'angle du défilé, comme chargeant un adversaire invisible, incapable de nous distinguer à cette distance, mais l'oeil allumé déjà d'une haine farouche, irrépressible. Les flancs lourds, épais, massifs. Le jaillissement d'une masse grise, déterminée, fondue tout entière dans la seule idée du combat.
Instinctivement, Ouangah s'est arc-bouté contre le volant, prêt au choc... De la bête ou de la jeep, qui tiendra ?
De chaque côté, la piste défile, avec son cortège d'épineux grêles. Comment se figurer paysage plus pelé, plus lépreux, plus proche encore de ce qu'on pourrait rencontrer au voisinage de l'enfer ? L'herbe rase en bouquets épars et roussis, presque nichés sous les pierres, les arbres maladifs aux ombres maigres, contournées, la chaleur encore torride d'une fin d'après-midi comme les autres, et la lumière déclinante – une lumière qui n'est désormais plus que fournaise, tout juste bonne à vous brûler la peau, gercer les lèvres, à fendiller la moindre parcelle organique sur son passage. Ici tout se craquelle, la terre, les bêtes, les hommes. Quelle différence y a-t-il réellement entre l'amas rocheux qui s'élève sur notre gauche, calciné par la chaleur, et mon visage tanné, parcouru de fines crevasses ? Une simple question d'échelle.
La jeep soulève un nuage de poussière assez semblable à celui que fait monter, droit devant, le rhinocéros. En se déposant sur nos fronts, nos pommettes, cet épais poudroiement cendreux se mêle à la sueur et finit par plaquer sur chacun de nous un masque grotesque. La large face d'Ouangah se fend d'un sourire blanc. De quel cirque sommes-nous les clowns ?
Dans notre dos, le soleil fait monter ses dernières gerbes de feu, mais nous n'avons plus d'yeux pour le maudire. Les regards sont braqués sur la bête. À bord de la jeep, pas un mot : désormais, tout s'exprime par les gestes, par les regards échangés à la vitesse de l'éclair...
Dans un instant, ce sera le choc...
Quelques heures plus tôt. Un matin de saison sèche, un matin bien ordinaire. Les enfants du village jouent dans la mare. Des piaillements d'oiseaux, des miaulements de chats écorchés.
Plus loin, des adolescents bâtissent la hutte où, dans moins d'une semaine, à la pleine lune, ils devront s'isoler pour vingt-huit jours, ainsi que l'exige le rituel d'initiation. Un ancien, l'air inquiet, les surveille, assis sur une souche, et prodigue parfois de brefs conseils, indiquant à droite, à gauche, les éléments qu'il convient d'assembler en priorité. Aussi attentifs soient-ils cependant, les jeunes gens ne s'empressent pas toujours dans la direction indiquée par le vieillard. Ils préfèrent courir, esquiver des coups imaginaires, se jeter en riant les palmes ou les branchages au visage. Tout est prétexte au jeu, une dernière fois, avant de devenir des hommes.
Au loin, les femmes se tiennent massées à l'extrémité ouest du village. Les femmes : corps élancés, seins nus, pagnes aux teintes vives noués autour de la taille et laissant à découvert, très haut, la cuisse gauche. Les femmes : après d'interminables conciliabules, elles se mettent en marche vers le lavoir, le panier à linge sur la tête. Allure fière et rythmée de gazelle, avec un sourire en passant devant la case du blanc.
La fille d'Ouangah a pris la tête. À peine pubère, elle possède déjà ce balancement des hanches comme un appel surgi du plus profond de la brousse, et surtout ce regard de félin, continuellement braqué, dirait-on, sur un foyer imaginaire – un point précis de l'horizon auquel elle lancerait un incessant défi. Mes mains viennent se blottir contre le rocher brun de sa gorge, ma joue presse le troupeau de moutons noirs qui la coiffe, et l'odeur lourde du suint m'étourdit. Ses lèvres humides, offertes, gorgées de sève. Un fruit mûr à prendre. Vite. Avant qu'elle ne se refuse au baiser (« la bouche est faite pour manger », expliquent fièrement les plus âgées de ses compagnes).
Un instant plus tard, au lavoir, le geste cadencé du battoir sur les étoffes multicolores. L'eau, presque silencieusement, filtre entre les doigts minces, glisse sur la palmure délicate et redescend en gouttes épaisses jusqu'aux ongles roses. Des grappes d'écume s'accrochent au-dessus de la tête, y dessinent un bref instant un nimbe diapré, puis retombent sur l'échine courbée avant de se perdre entre les reins.
La lente mélopée des travailleuses s'élève dans le frémissement de l'air chaud.
C'est elle qui guide le chant de ses sœurs. Prosternée sur son ouvrage, elle semble n'être guère préoccupée que par l'écheveau d'onomatopées qu'elle emmêle comme à plaisir. Tournant le dos, elle ne me voit pas, et ne paraît pas sentir non plus la gouttelette d'eau parfaitement ronde qui glisse entre ses omoplates... Pourtant... S'attarder une seconde au chemin que parcourt cette perle translucide, idéalement moulée, c'est comprendre que tout est contenu dans son ventre sphérique, et que de sa chute dépend la bonne marche du monde. C'est mesurer l'envie irrésistible qui ne peut que vous gagner un jour, à force de la contempler ainsi, agenouillée sur la berge. La prendre. Affronter le plus féroce, le plus farouche des mâles de la tribu, risquer le sang répandu et la honte du vaincu, mais conquérir le droit de l'étreindre.
Il fait nuit dans la forêt sacrée. Les tambours nuptiaux ont longtemps roulé et c'est à présent aux incantations de fuser, de se répondre d'arbre en arbre. On nous a coiffés des masques rituels avant de nous conduire solennellement dans la clairière du Grand Combat. L'adversaire est à vingt pas. Il danse d'un pied sur l'autre, brandissant vers le ciel d'encre la longue lance des duels. Moi, en face, sous le regard paisible de la lune, je suis sans doute l'exacte réplique de cet être sautillant. Animé du même espoir : basculer son corps de déesse d'ébène, son corps ancestral et frêle. L'appel de la floraison, de la montée de sève. Se soumettre aux cycles oubliés, aux époques de rut, au combat des mâles.
Se soumettre à cette voix encore fluette, qui s'élève bien au-dessus du faux-bourdon hésitant des autres travailleuses... Mais la goutte d'eau vient de se perdre dans les plis du pagne. Le jour a repris possession de son domaine. Implacable, il incendie les moindres recoins au bord du fleuve. Bientôt, elles auront terminé la lessive.
La procession des statuettes longilignes regagne majestueusement le village. Les paniers d'osier, sur les têtes, sont pleins du linge encore ruisselant.
C'est alors l'odeur douceâtre du mil qu'on broie, la scansion uniforme des bras sur le pilon, rythmant la danse des seins, lourds des promesses de la nuit. Et toujours la monodie lancinante.
Elle ne se taira qu'au moment du déjeuner. Au moment où je pénétrerai dans la case d'Ouangah. Le repas sera simple, rapidement pris, et suivi d'une conversation languissante, entrecoupée de courts sommes, de périodes de silence consacrées à la dégustation de l'alcool de palme, le tchembo, éclairées par l'inaltérable sourire de mon hôte. Un sourire de gamin, plein de lumière et de chaleur, qui parle de journée propice à la chasse ou à la pêche, de saison sèche, de périodes de frai, de rhinocéros...
Les enfants courent derrière la jeep jusqu'à la sortie du village. Les femmes n'ont levé les yeux qu'un instant, le temps de poser un regard sur les chasseurs.
Un chant incertain monte – est-ce elle, une dernière fois ? Puis le ronronnement du moteur, les arbres qui se font plus rares, la piste qui grimpe brusquement en lacets, parmi les taillis, les broussailles, jusqu'à la désolation, la poussière...
Le gris omniprésent du plateau s'étend sur chaque chose, ciel et terre. Pas une herbe qui soit réellement verte. Tout, jusqu'au visage d'Ouangah, s'est subitement terni, comme si le monde s'était couvert, jusque dans ses ultimes recoins d'une fine pellicule d'étain. Tout suffoque sous cette chape, tandis que le frisson de l'air brûlant anime le paysage d'un sursaut d'agonie.
Le dernier virage. C'est Ouangah qui, le premier, a aperçu le rhinocéros. Aussitôt, son pied a enfoncé l'accélérateur. J'ai serré mon fusil, mais il est désormais trop tard pour tenter quoi que ce soit.
Dans un instant ce sera le choc...
À des milliers de kilomètres d'ici, se déploient d'autres paysages. Verts, ceux-ci. Avec des enfants tristes qui partent pour l'école, leur cartable sur le dos. Ils parlent de royaumes oubliés où les attend une princesse indigène, ils parlent de terres lointaines, et parfois de safari, de chasse à l'éléphant ou au rhinocéros...
Là-bas, une poignée d'hommes vit la véritable aventure de la vie. Le jeu de la Bourse, des sociétés multinationales, des usines, des bilans et des faillites. Le jeu où, à de rares exceptions près – et cette sublime incertitude donne tout son sel à leur existence – les gagnants triomphent de père en fils. Le jeu où deux et deux ne sauraient faire autre chose que quatre, puisque tout est arrangé pour qu'il en soit ainsi.
Là-bas, les femmes ont bien d'autres occupations que chanter en battant la lessive ou en pilant le mil. Il leur faut apprendre à attendre, à apprivoiser, à piéger ou à se vendre. Chairs blanches sur des draps bleu tendre. Sous le ventre laiteux, frisson presque invisible de la toison à l'instant où leurs gestes d'ivoire éclaboussent la nuit.
Ici les femmes dorment sur une natte. Mais le noir qui les charbonne ne les empêche pas de faire une fête aussi splendide de leur corps. Et c'est grâce à ces enlacements nègres que je vis, peut-être parce qu'on m'a mis au monde, il y a des siècles. Peut-être parce que je suis sorti en piaillant de leurs cuisses de jais, au cœur d'une forêt fiévreuse, chaude et humide. Peut-être parce que mon âme est tam-tam. Depuis quelques secondes, cette évidence vient de jaillir : au fond de moi, je ne suis pas blanc...
Les deux nuages de poussière, celui de la jeep et celui de la bête vont bientôt se rejoindre. Et c'est seulement à présent, dans la mêlée confuse qui se forme, qu'Ouangah et moi découvrons, presque en même temps, qu'un spectateur inattendu assiste au combat.
Son dos luisant tache une portion de terre herbeuse, sur la droite. Nous n'avions pas eu encore le loisir de remarquer ce lambeau de vert cru qui fait injure au désert, ni cette silhouette sombre qui en occupe le centre. La femelle guette le moment de l'affrontement.
Un flot d'images déferle dans ma mémoire. Vagues instantanés d'une nuit de pleine lune, d'une forêt noyée d'ombre, d'un guerrier masqué brandissant sa lance. J'entends la mélopée s'échapper de cent bouches, une dernière fois.
Dans un instant, ce sera le choc.
Tout se passera dans cette confusion de poussière et de cendre qui déjà nous aveugle.
Le coup broiera ma belle défense, et je roulerai dans les broussailles avec mon gros corps lourd, épais et frémissant, vaincu par ces hommes qui n'en finiront jamais de s'ennuyer.
Mon gros corps lourd de rhinocéros...
*
* *
Ce soir-là, une jeune fille – c'était l'aînée des enfants d'Ouangah – découvrit, dans les taillis du haut plateau, les carcasses inertes de deux rhinocéros. Une femelle, barétant à la mort, léchait encore le sang des deux bêtes.
Les mâles s'étaient livré un duel sans merci.
Mais de son père et du missionnaire blanc qui l'accompagnait, elle ne trouva nulle trace. Tout avait disparu, jusqu'à la jeep qui les avait emportés.
Aussi, puisqu'elle était fille de chef et désormais orpheline, N'Gu décida que, le soir même, tous se rendraient en procession jusqu'à la clairière sacrée. On y psalmodierait les Chants de l'Union, puis les plus valeureux des guerriers s'affronteraient la nuit durant dans un périlleux combat nuptial...
Récit publié à l'origine dans L'Encrier renversé, mars 1992, p. 24-27.

dimanche 21 février 2010

Albrecht Dürer, Rhinocéros, bois gravé, 1515
Les rhinocéros sont des animaux massifs et puissants. Ils sont timides et craintifs. Ils n'attaquent que quand ils sont dérangés.
On tire le rhinocéros de jour. Sa charge est impressionnante.
Grand Larousse encyclopédique